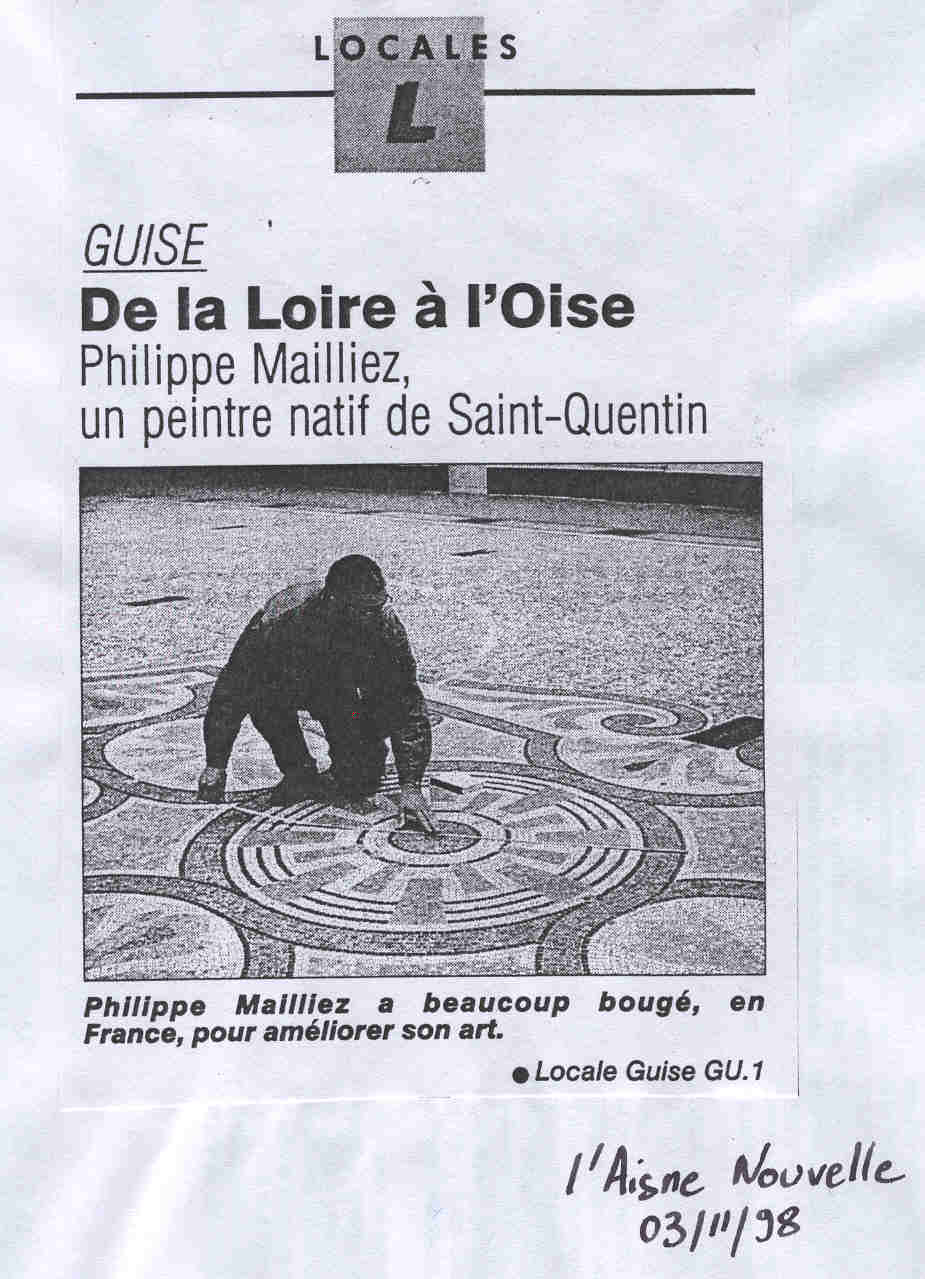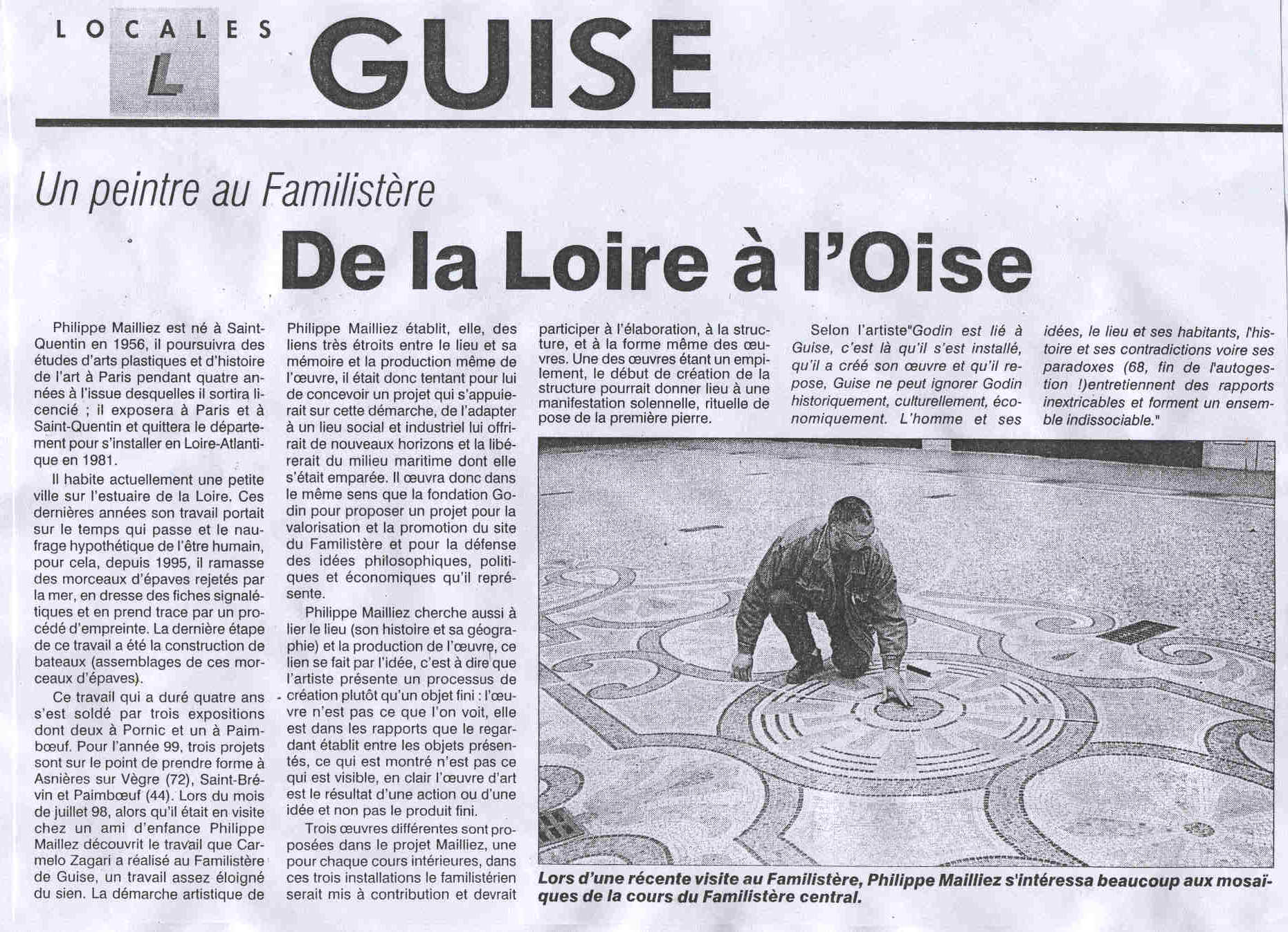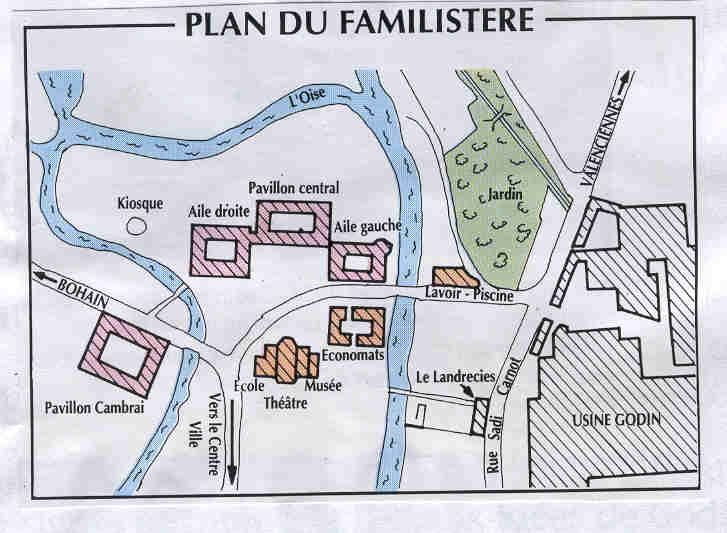
Qu 'est ce qui a incité Philippe Mailliez à concevoir
projet ?
Lors du mois de juillet 98 alors qu'il passait quelques semaines de
vacances chez son ami d'enfance à Guise (02), Philippe Mailliez découvrit le
travail que Carmelo Zagari a réalisé au Familistère (travail assez
éloigné du sien).
Sa démarche artistique, depuis 1995, comme nous le verrons plus loin, établit
des liens très étroits entre le lieu et sa mémoire et la production même de l'œuvre.
Il était tentant pour lui de concevoir un projet qui s'appuierait sur cette
démarche. L'adapter à un lieu social et industriel lui offrirait de nouveaux
horizons et la libérerait du milieu maritime qui peu à peu s'était emparé
d'elle (Pornic, Paimboeuf, St Brévin). Appliquer ou plutôt ajuster sa
démarche à un autre milieu, Philippe Mailliez tente déjà l'expérience à
Asnières sur Végre (projet d'installation pour le mois de juin 99), mais
l'élément aquatique (la rivière cette fois ci) est toujours présent. Le
projet pour le Familistère de Guise prend pour lui une double dimension, c'est
tout d'abord un défit, presque une gageure et aussi un retour au pays de sa
jeunesse.
Le travail proposé ici par Philippe Mailliez permet d'appréhender d'une façon
différente la pensée de Godin. Il modifie notre regard. Il oeuvre dans le
même sens que l'AFPG pour la valorisation et la promotion du site du
familistère et pour la défense des idées philosophiques, politiques et
économiques qu'il représente.
Comment ce projet s'inscrit-il dans sa démarche d'art
Depuis 95 Philippe Mailliez cherche à lier le lieu (son
histoire, sa géographie) et la production de l'œuvre. Ce lien se fait par
l'Idée. C'est à dire que l'artiste présente un processus plutôt qu'un objet
fini. L'œuvre n'est pas ce que l'on voit, elle est ailleurs, elle est dans les
rapports que le regardant établit entre les objets présentés. Ces objets sont
à la fois des traces d'un processus de fabrication et des indices pour une
pensée à venir .
Il ne s'agit pas d'un travail sur la représentation paraphrasée ou
métaphorique de l'allégorie. Nous ne sommes pas ici dans le "representamen"
car ce travail dépasse le symbole qui peut être considéré comme une
représentation statique de l'Idée. Nous sommes ici dans l'ordre du signe
"signum" c'est à dire que ce qui est visible est un résultat. Ceci
implique une présence active de l'Idée. Ce qui est à voir n'est pas
uniquement le produit fini mais le processus même. Ce qui est montré n'est pas
ce qui est visible.
Le signum permet aussi une réflexion à rebours, si nous osons ce pléonasme.
C'est à dire que l'œuvre d'art, résultat d'une action et d'une idée (ou
d'une idée par une action) est aussi une source, un point déclenchant d'une
pensée du regardant.
"Ainsi l'Art ne demande pas que le
travail du regard, ni même celu1 de tous les sens que postulat Beuys, mais le
cheminement d'une conscience élaborant un savo1r, dont l'œuvre d'Art aura
été la source, le facteur déterminant ...
...L 'oeuvre d'Art contemporain postule donc un phénomène que j'appellerai la
"raisonnance" c'est à d1re l'organisation d'un certain nombre de
savoirs et d'actes par et pour lesquels se structure et se réalise l'œuvre qui
est par cela même oeuvre d'Art, et non par je ne sais quelle application
plastique. "
Jean Marie TOURATIER "L'autre, le regard, l'espace"
Art
Press n° 220
Le signe joue donc sur 2 registres
1) Il est le résultat d'une action
2) Il est un point de départ d'une pensée réflexive (la raisonnance) Le signe
est une articulation entre le travail en amont (celui de l'artiste en action) et
le travail en aval (travail demandé ou proposé au regardant par l'artiste,
c'est à dire une appropriation de ce signe qui joue alors le rôle de facteur
déclenchant ou de catalyseur pour une réflexion personnelle)
Le signe est une articulation temporelle et causale.
Articulation temporelle: le résultat (fin d'une action) / la source {début
d'une réflexion)
Articulation causale: Il permet de mettre en relation la pensée de l'artiste à
travers ses actions et ses productions et la Culture du regardant.
"Le dispositif de l'œuvre contemporaine exige dans son ultra matérialité un sujet qui travaille, qui élabore, qui engendre du sens, qui accepte ce qui en lui le change par ce qu 'il amène dans ce qu'il voit, pressent, ressent, consent".
j.M. Touratier
la difficulté du travail de Philippe Mailliez est de ne pas
atteindre le symbole. Comment une forme peut devenir un signe sans être un
symbole ? Comment rester significatif sans être symbolique ? À quel moment la
forme bascule dans le symbole et se fige ? Où est la limite ? Quel peut être
le rapport de cette limite avec la Culture ? Comment l'ouverture permise par le
signe se ferme-t-elle dès qu'il devient symbole ?
De nombreuses questions auxquelles Philippe Mailliez est confronté et qu'il
rencontre comme autant d'écueils à la mise en oeuvre et au fonctionnement de
sa démarche. Il y aune sorte de retenue dans son travail. cette peur d'en dire
trop ou de n'en dire pas assez. Il est tentant de charger
sémantiquement un signe. Trop lui donner de sens réduit son rôle de
catalyseur permettant une pensée tous azimuts. Le symbole est directif car mono-sémantique.
Les sculpteurs du XIII ème siècle l'avaient bien compris.
La finalité de la démarche artistique n'est donc plus la production d'objets
finis mais de signes déclenchant la réflexion du regardant. C'est une machine
à faire penser, à donner à penser. C'est un travail ouvert, respectueux de
l'individu, loin de la pensée unique, impérieuse. C'est un travail dynamique
sur les conceptions par la manipulation artistique des concepts. Nous entendons
par manipulation artistique des concepts, une traduction analytique des concepts
par le biais de l'Art ou de tout ce qui fait l'Art: forme, contexte,
infrastructure, processus artistique ...
Dans ce projet, la difficulté de ce travail réside dans le fait que
l'infrastructure (lieu social: habitation, lieu industriel: travail de la fonte)
n'agit pas en faveur d'une définition artistique de ce qui est montré, comme
une galerie ou un musée pourrait le faire.
Le contexte lui étant plus favorable, il nous faut donc nous intéresser soit
au processus, soit à la forme: l'esthétique. Mais peut-on définir une
esthétique de l'Art contemporain ? y a-t-il des canons ? N'y a-t-il pas eu
stérilisation de tout canon depuis Marcel Duchamp ?
Qu'est ce qui fait la contemporanéité d'une oeuvre ?
Il nous faudra donc privilégier le processus artistique sans toute fois
délaisser le travail sur la forme pour concevoir et produire des signes et non
des représentations.
Il nous paraît possible d'établir un parallèle entre cette proposition et la
pensée et les actes de Jean Baptiste André Godin que nous pourrions qualifier
d'utopie pragmatique si nous acceptons cet antagonisme.
Le travail artistique sera donc de proposer des signes ou des ensemble de signes
étroitement liés aux idées de Godin telles que la volonté, la fraternité,
la solidarité, l'association, l'autogestion.
Conception des signes
L'architecture même va nous donner, voire imposer certaines orientations. Les trois pavillons à usage et à histoire différents et à cour centrale couverte, détermineront le nombre et l'emplacement des oeuvres.
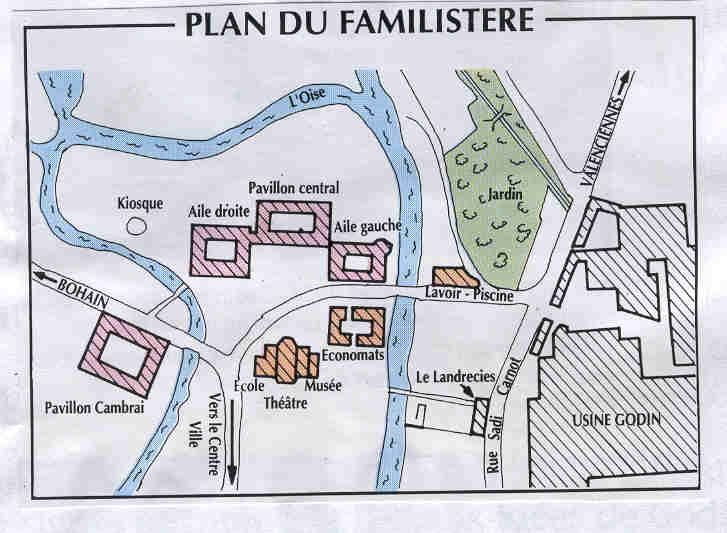
Trois oeuvres différentes donc, au centre des trois cours
intérieures, l'emplacement central correspondant bien aux idées communautaires
et familiales de Godin.
Ces oeuvres seront des installations. (lire le pourquoi en guise de conclusions
)
La première de ces installations "le tas de briques" sera une oeuvre
politique, elle mettra en évidence les idées socialistes et autogestionnaires
de Godin: la responsabilité, la participation, la responsabilité et la
solidarité.
Elle demandera de la part des habitants une action.
La deuxième "le sociogramme" traitera de l'homme comme être social c'est à dire dans sa relation avec les autres. Godin avait bien compris que contrairement à Fourrier, Gabet, ou Considérant, il ne devait pas construire son projet de Familistère en partant de l'Homme idéal. Godin était d'abord un ouvrier qui avait souffert de l'exploitation du patronnât. Il inventa donc de nouveaux rapports entre l'Entreprise et les ouvriers, entre les hommes dans leur vie quotidienne (Famille, économie, entraide, communauté, partage...). Elle demandera de la part des habitants une déclaration.
La troisième "l'exhumation" parlera de l'individu,
de sa condition économique (victuailles), de son histoire (souvenirs), de ses
faces cachées, souterraines (la cave). Elle lui demandera de s'engager, de
prendre part en dévoilant, en déterrant ce qui pourrait appartenir à
l'intimité.
Elle demandera de la part des habitants un choix.
Dans ces trois installations le familistérien sera mis à contribution, il devra participer à l'élaboration (sociogramme), à la structure (tas de briques) et à la forme (exhumation) même des oeuvres.
Annexe
À la question "qu'est ce qui fait la
contemporanéité d'une oeuvre ?" nous pourrions répondre en citant un
extrait d'un texte de Cyril Jarton "l'art en train de se faire" (Art
Press. n°222 mars 97), texte qui peut cautionner la démarche de Philippe
Mailliez qui est de lier le lieu et l'œuvre par l'Idée et l'Action :
"Nous
entrons dans la contemporanéité dès lors qu'une pratique met en cause le
légitimité des relations de références culturelles qui depuis la Grèce de
Platon jusqu'à la fin de années 1970, ont servi à désigner les oeuvres d'art
:
-le
goût, en tant que médiation nécessaire entre un objet et une idée du Beau;
-le
travail du médium, dans la mesure où l'élucidation du médium par lui-même
objective l'essence de l'Art;
-enfin
le rôle politique de l'art en tant qu'accès privilégié à une dimension
utopique transformable de la société.
Si toute
oeuvre entretient un rapport plus ou moins éloigné au goût, au politique et
à son médium, force est néanmoins d'admettre qu'aucune de ces déterminations
n'est aujourd'hui à même de rendre compte globalement des enjeux d'une
démarche artistique...
Le
goût, le médium-vérité et le projet politique apparaissent donc dans l'art
contemporain comme des manifestations historiques de l'art dont aucune, en fait,
n'entretient un rapport de nécessité avec le concept d'art. Le goût, la
vérité, la politique définissent l'art à partir d'une désignation
extérieure.
Or l'art
contemporain n'est pas tant l'inscription de .
l'art dans son époque (tout art réalisé aujourd'hui est nécessairement
contemporain) que la contemporanéité de l'art et de son concept. Autrement
dit, la contemporanéité de l'art et de son concept postule que l'activité
artistique se définit en elle-même, performativement sans recourir à des
théories culturelles extérieures à l'art (la doxa da l'art, la sociologie de
l'art, la psychanalyse de l'art, la philosophie de l'art, l'histoire de l'art).
L 'art contemporain est l'art qui, en se produisant, instaure simultanément et
autoréférentiellement l'idée d'art ainsi que l'espace au sein duquel il est
de l'art. Cette intégration d'un environnement sensible et conceptuel au sein
de la pratique est précisément ce Qui fait la contemporanéité. "
A) Construction. empilement au centre du pavillon central (Genèse, choix et justifications)
"À ceux qui déplorent que l'architecture adoptée peut rappeler de la caserne ou du coron, du tas de briques, dit le guisard et qui regrettent que Godin n 'ait pas adopté plutôt la cité-jardin, je répondrai que tel quel cela est admirable parce que créé en un temps où l'ouvrier était voué au taudis sans eau, ni gaz, ni fenêtres. "
le pays de Guise p. 113
 Au
centre de la cour du pavillon central Philippe Mailliez propose de créer un
"tas de briques", empilement cylindrique composé de 1000 briques
certaines en terre cuite (environ 700), d'autres en fonte émaillée et
d'autres, enfin, dorées à la feuille d'or .
Au
centre de la cour du pavillon central Philippe Mailliez propose de créer un
"tas de briques", empilement cylindrique composé de 1000 briques
certaines en terre cuite (environ 700), d'autres en fonte émaillée et
d'autres, enfin, dorées à la feuille d'or .
Pourquoi préférer une construction ordonnée en forme de cylindre à l'aspect
informel et aléatoire d'un tas de brique.
La forme du cylindre est apparue à Philippe Mailliez, comme une évidence
impérieuse, sorte de symbole de la ville même de Guise. C'est tout d'abord la tour
du château qui domine la ville c'est aussi l'image du poêle
Godin tel qu'il est dans l'esprit de beaucoup de personnes: "Le Petit
Godin".
Le cylindre, libéré ici de toute connotation sexuelle, est pensé, puisque
nous parlons architecture, plutôt comme une tour de Babel, unifiant des gens de
toutes conditions, dans une même action, vers un seul but, un seul idéal qu'on
pourrait appeler, dans notre recherche, Progrès Social et Prospérité...
Disposer les briques en un tas informel réactiverait les anciens conflits entre
les guisards et le microcosme Godin.
Ériger une forme cylindrique c'est établir un lien entre la ville (le
château) et l'Entreprise par le biais de l'une de ses productions (le petit
Godin)
Quand le camion livrera les 1000 briques, cela fera un "tas". C'est
l'action des habitants qui fera de ce tas une construction (le cylindre). C'est
une valorisation du tas de briques, c'est le passage de l'objet quotidien,
industriel à l'objet d'Art par simple manipulation. L'ajout de la photo
d'identité et le déplacement intentionnel (geste d'artiste) dans ce lieu et
dans ce contexte permettront l'émergence du signe.
1) les briques de terre cuite
Une brique / un familistérien
Sur chaque brique de terre sera collée une photo d'identité de chaque habitant
du Familistère. Chacun sera invité à apporter sa pierre
à l'édifice, c'est à dire à positionner, lui même, sa brique identifiée,
personnalisée dans le processus d'édification du cylindre prévu. Ainsi l'œuvre
sera construite, édifiée par les habitants mêmes du Familistère ( environ
700 personnes).
La pose des briques se fera sans ciment, ni colle, ce ne sera qu'un simple
empilement. Cet édifice fragile reposera sur la présence, l'acte de chacun
(rôle et travail).
Responsabilité, confiance, union, solidarité ...
Enlevez donc une brique et, comme un château de cartes, tout s'écroule.
L'empilement commencera, comme toute architecture par la pose de la première
pierre. Action qui pourrait donner lieu à une manifestation solennelle,
rituelle, avec musique et médias.
La construction pourrait faire, elle l'objet d'un film vidéo.
2) les briques de fonte
Afin de bien marquer le rapport entre l'Homme et l'Entreprise, seront
placés dans l'empilement des objets de fonte émaillée, de la forme et de la
taille d'une brique, sur lesquels seront inscrits en relief des mots (procédé
de moulage comme pour les poêles). Ces mots formeront une des phrases les plus
importantes du texte de Godin pour la création de "l'association
coopérative du Familistère de Guise" 1880. (phrase restant à choisir).
Lors de la pose des briques de fonte dans l'empilement il faudra faire bien
attention à la régularité, du rythme, de cette insertion, qui se fera à
l'envers c'est à dire, comme l'élévation du cylindre se fait de bas en haut,
si on ose cette Lapalissade, il faudra commencer par placer le dernier mot de la
phrase pour terminer par le premier, si on veut conserver le sens de lecture
ordinaire de haut en bas et de gauche à droite.
3) les briques dorées à la feuille d'or
Ce sont les "équivalents richesse". Ce sont des équivalents
de lingots d'or, mais ce sont quand même quelques briques.
Ces briques au nombre pour l'instant indéterminé seront réparties
régulièrement dans l'empilement.
Elles créeront, par leur couleur un contraste intéressant entre le rouge de la
terre cuite et l'émail de la fonte (noir ou bleu).
Ainsi les habitants du Familistère sont invités à devenir copropriétaire et
coauteur de l'œuvre d'art par l'Action (le travail) : déposer une brique, ce
travail sera associé au Capital: briques de fonte (Association du capital au
travail) et ce qui constituera pour eux ainsi un équivalent richesse (briques
dorées).
B) Sociogramme dans la cour du pavillon droit
 "Plusieurs
centaines d'appartements répondant à des normes d'hygiène, de confort et de
sécurité tout à fait révolutionnaires pour l'époque, reliés entre eux par
une rue galerie" donnant ainsi la priorité aux facilités de communication
(pour susciter et entretenir la solidarité et la fraternité, constituent un
ensemble que nos architectes urbanistes contemporains n'hésitent pas à citer
en exemple sinon à imiter, du moins à méditer. "
"Plusieurs
centaines d'appartements répondant à des normes d'hygiène, de confort et de
sécurité tout à fait révolutionnaires pour l'époque, reliés entre eux par
une rue galerie" donnant ainsi la priorité aux facilités de communication
(pour susciter et entretenir la solidarité et la fraternité, constituent un
ensemble que nos architectes urbanistes contemporains n'hésitent pas à citer
en exemple sinon à imiter, du moins à méditer. "
Solidarité, fraternité, communication, voilà ce qui va nous
guider dans la construction d'un ensemble de signes pour une installation dans
la cour du pavillon droit.
Penser l'architecture autour des rapports humains, c'est l'idée de Godin. La
recherche d'une forme nous a menés à concevoir une sorte de sociogramme
géant, grandeur nature, c'est à dire à la taille humaine. Construire un
sociogramme, c'est d'abord faire un sondage, mener une enquête, ce qui implique
la construction d'un questionnaire.
L'objectif de ce questionnaire est dans notre projet artistique d'établir une
mise en relation entre les appartements (puisqu'on est dans la recherche d'une
forme) en partant des relations avouées et déclarées des habitants entre eux.
Le questionnaire n'est pas encore établi mais les questions porteront sur la
fréquentation des habitants, la fréquence et la nature de ces rapports. Il
s'agit là, certes, de quelque chose d'intime, il n'y aura donc aucune
obligation de réponses ni de questions délicates ou pouvant mettre quiconque
en difficulté.
Exemples de questions
Connaissez vous le nom des
habitants de l'appartement n° X ?
Quelles personnes habitant le
pavillon vous ont elles déjà invité à manger ?
Chez qui prenez vous le café ou
l'apéritif ?
Vos enfants ont ils des copains
dans le pavillon ? ...etc.
Les réponses, une fois étudiées, seront matérialisées par des fils de
cuivre tendus entre les appartements en relation. Les fils seront attachés au
garde-fou. Le cuivre c'est le conducteur, c'est la connection électrique. Le
courant passe. Les hommes se branchent entre eux, c'est leur énergie, c'est la
force de l'entreprise Godin, un des secrets de sa réussite.
Ainsi va se tisser une toile sociale, un réseau de fraternité et
d'entraide, une vraie vie de communauté.
Au sol seront disposés de grands miroirs qui renverront une image inversée de
la verrière , la seule avec une charpente métallique.
Le miroir c'est une inversion des points de vue, un
retournement perspectif, mais aussi une sorte de rétroviseur dans sa propre
vie, un regard vers son passé, vers l'enfance.
C'est l'image de soi, celle qui s'impose à vous chaque matin dans la salle de
bain. C'est dans son miroir que l'on découvre la première ride, le premier
cheveux blanc...
C'est encore l'image qu'on veut donner aux autres, celle du paraître, de la
représentation. C'est dans son miroir que l'on soigne son maquillage, que l'on
vérifie sa coiffure ou que les larmes n'ont pas laissé de petites traces
salées sur les joues ...
L'installation ainsi pensée met en scène chacun dans ce qu'il a d'intime dans
sa relation avec l'Autre, ou comment l'image de soi est essentiellement tournée
vers autrui.
C'est l'éternelle question de l'être et du paraître.
C) L'Exhumation
 Après
avoir proposé des signes pour une réflexion politique dans la cour du pavillon
central (le tas de briques), des signes pour une analyse de l'Homme en tant
qu'être social c'est à dire un être qui se définit par ses relations avec
autrui (sociogramme), il restait à proposer des pistes d'études de l'individu,
c'est à dire de l'homme en prise avec son histoire intime, ses peurs et ses
souvenirs. La cour de l'aile droite est la seule à posséder des grilles
d'aération circulaires. Il était donc intéressant de partir de cette
particularité. Ces grilles aèrent les caves qui sont au sous-sol. Il existe
donc un niveau inférieur, un niveau caché, des caves où chacun entasse
victuailles (le garde-manger) et objets de rebut. Ces objets qu'on n'a pas osé
jeter -souvenirs- objets auxquels in était attaché, au point de ne pas pouvoir
s'en débarrasser, mais dont les liens se sont distendus au point des les
remiser jusqu'à l'oubli (les garde- vies). C'est cette mémoire cachée que la
dernière installation veut rendre vive. Philippe Mailliez propose aux
propriétaires de caves d'exhumer un objet, de le remonter au grand jour, de
l'exposer. Le choix que chacun fera ne sera pas innocent et peut être lourd de
signification. Un passé resurgit, une anecdote, un petit regret ou un grand
changement. Témoins d'une vie interne, fonctionnelle, différente de celle que
l'on étale au grand jour (la vie relationnelle mise en évidence dans l'aile
gauche). Cet objet peut appartenir au consommable: objet alimentaire tourné
vers l'avenir ou appartenir aux souvenirs et alors être porteur de sens pour
son propriétaire (vestige du passé).
Après
avoir proposé des signes pour une réflexion politique dans la cour du pavillon
central (le tas de briques), des signes pour une analyse de l'Homme en tant
qu'être social c'est à dire un être qui se définit par ses relations avec
autrui (sociogramme), il restait à proposer des pistes d'études de l'individu,
c'est à dire de l'homme en prise avec son histoire intime, ses peurs et ses
souvenirs. La cour de l'aile droite est la seule à posséder des grilles
d'aération circulaires. Il était donc intéressant de partir de cette
particularité. Ces grilles aèrent les caves qui sont au sous-sol. Il existe
donc un niveau inférieur, un niveau caché, des caves où chacun entasse
victuailles (le garde-manger) et objets de rebut. Ces objets qu'on n'a pas osé
jeter -souvenirs- objets auxquels in était attaché, au point de ne pas pouvoir
s'en débarrasser, mais dont les liens se sont distendus au point des les
remiser jusqu'à l'oubli (les garde- vies). C'est cette mémoire cachée que la
dernière installation veut rendre vive. Philippe Mailliez propose aux
propriétaires de caves d'exhumer un objet, de le remonter au grand jour, de
l'exposer. Le choix que chacun fera ne sera pas innocent et peut être lourd de
signification. Un passé resurgit, une anecdote, un petit regret ou un grand
changement. Témoins d'une vie interne, fonctionnelle, différente de celle que
l'on étale au grand jour (la vie relationnelle mise en évidence dans l'aile
gauche). Cet objet peut appartenir au consommable: objet alimentaire tourné
vers l'avenir ou appartenir aux souvenirs et alors être porteur de sens pour
son propriétaire (vestige du passé).
Cet objet sera disposé sur une stèle ( cylindre dont la base sera égale aux
grilles d'aération sur lesquelles elles seront posées et dont la hauteur sera
d'environ 2,20 m c'est à dire supérieure à la hauteur humaine et inférieure
à la base du premier étage.) Ces stèles vont créer alors un nouveau niveau,
qui ne sera visible que des étages mais que l'on devinera du sol, en levant les
yeux, un peu comme on soupçonne l'existence du niveau inférieur en regardant
par terre. Du bas une forêt de colonnes à la Buren, d'en haut, une collection
d'objets hétéroclites à la Fluxus.
Pourquoi des installations ?
Godin est lié à Guise, c'est là qu'il s'est installé,
qu'il a créé son OEuvre et qu'il repose. Guise ne peut ignorer Godin,
historiquement, culturellement, économiquement. L 'homme et ses idées, le lieu
et ses habitants, l'Histoire et ses contradictions voire ses paradoxes (68 : fin
de l'autogestion !) entretiennent des rapports inextricables et forment un
ensemble indissociable. L'installation est une inscription dans le temps. Par
définition c'est quelque chose qu'on installe et qu'on
"désinstalle". C'est marquer le temps dans ce qu'il a d'éphémère.
C'est inscrire un lieu dans un instant. C'est aussi marquer un moment dans un
lieu: c'est une manifestation.
Il faudra des traces.
Le reportage photographique agira comme mémoire, comme témoignage aux absents,
comme recherche d'extension de l'instant: la pérennisation.
L'installation donne à l'Idée seule le statut d'œuvre d'Art, en effet, le tas
de briques, le sociogramme ou l'exhumation, pourront se refaire à d'autres
moments, d'autres années, à d'autres époques mais les formes (les visages,
les relations inter appartements ou les objets exhumés) ne seront plus jamais
les même, jamais figées, chaque fois renouvelées, chaque fois liées au
"maintenant", à l'individu et à ses rapports sociaux.